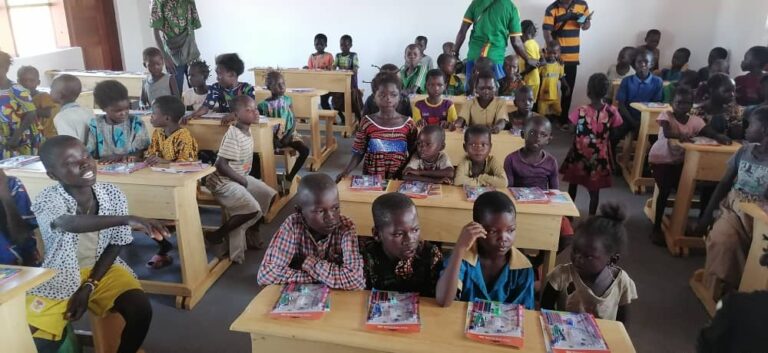24 mars 2013 – 24 mars 2025, douze ans se sont écoulés depuis l’attaque de la rébellion Séléka sur Bangui, marquant le renversement du régime de François Bozizé après une vaste offensive sur plusieurs villes et régions du pays. Cette crise, qui a plongé la Centrafrique dans le chaos, a failli conduire à un génocide, entraînant l’intervention de la communauté internationale et la mise en place de la MINUSCA pour stabiliser le pays.
Entre 2013 et 2014, la République centrafricaine a connu l’une des périodes les plus sombres de son histoire. Exécutions sommaires, violences intercommunautaires, pillages, viols et déplacements massifs de populations ont été les conséquences directes du conflit entre la Séléka et les groupes d’autodéfense Anti-balaka. L’affrontement entre ces factions a aggravé les tensions ethniques et religieuses, poussant des milliers de Centrafricains à l’exil.
Face à la montée de ces violences, la communauté internationale a réagi en envoyant les forces françaises de l’opération Sangaris et en déployant la MINUSCA (Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en Centrafrique), avec pour objectif de restaurer l’ordre et d’accompagner le processus de paix.
Douze ans après ces événements tragiques, la question de l’impunité demeure préoccupante. Si certaines figures de la rébellion et des milices Anti-balaka ont été jugées, plusieurs auteurs présumés de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité restent encore libres. La Cour pénale spéciale (CPS), mise en place pour juger les responsables des atrocités commises pendant la crise, peine à fonctionner efficacement, notamment en raison du manque de moyens et de la pression politique.
Le 12 décembre 2022, Mahamat Said Abdel Kani, ancien commandant de la Séléka, a été jugé par la Cour pénale internationale (CPI), marquant une avancée significative. Cependant, de nombreux autres responsables des exactions continuent de jouir d’une liberté totale, alimentant un sentiment de frustration parmi les victimes.
Depuis 2013, la Centrafrique a traversé plusieurs étapes de transition politique :En 2016, l’élection de Faustin-Archange Touadéra a été perçue comme une lueur d’espoir pour la reconstruction du pays. En 2019, un accord de paix a été signé entre le gouvernement et quatorze groupes armés sous l’égide de l’Union africaine, mais son application est restée fragile. En 2020, malgré les tentatives de déstabilisation de la Coalition des Patriotes pour le Changement (CPC), Touadéra a été réélu.
Cependant, les défis sécuritaires et économiques restent majeurs. La présence de groupes armés dans plusieurs régions du pays, les tensions politiques et la précarité de nombreuses populations continuent de freiner la stabilisation du pays.
À l’occasion de ce triste 12ᵉ anniversaire, de nombreuses voix s’élèvent pour exiger la fin de l’impunité, la poursuite des criminels de guerre et une véritable réconciliation nationale. Malgré les efforts déployés, la mémoire des victimes reste vive, et les attentes en matière de justice et de réparation sont encore nombreuses.
L’avenir de la République centrafricaine dépendra de sa capacité à consolider la paix, instaurer une justice équitable et garantir un avenir meilleur aux générations futures.
En 2023, un référendum controversé a conduit à la modification de la Constitution, permettant au président en place de briguer un troisième mandat.
Par la rédaction RAVOCI